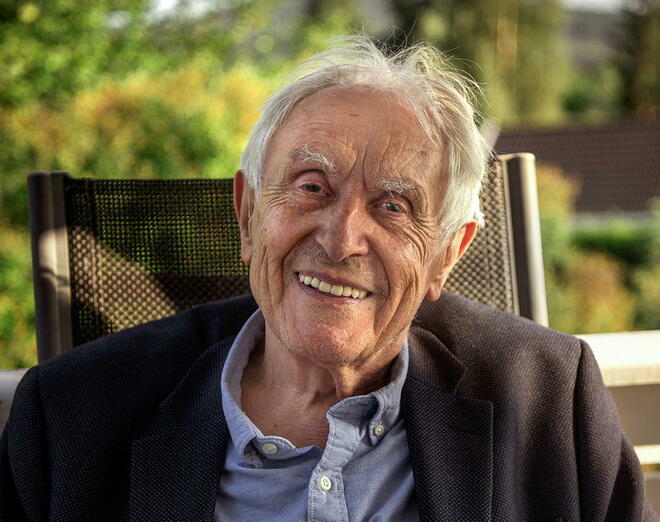Quand j’ai découvert le travail Racky Ka Sy, il y a quelques années, j’ai été très inspiré par son parcours et sa vision de la psychologie.
Racky Ka Sy a une approche unique. Elle est psychologue certe mais aussi docteure en psychologie sociale.
Cette double casquette lui permet d’analyser différemment le monde et notamment les questions du racisme et de son impact au sein de la société.
Grâce à son travail, elle participe grandement à la prise de conscience de nos biais racistes, afin de mieux les combattre
Dans cet épisode Racky Ka Sy, nous explique comment elle forme les futurs soignants/soignantes dans leur pratique à déconstruire leurs pensées et surtout à mieux accompagner leurs patientes, quelle que soient leurs origines.
Parce qu’il est primordial que le monde de la santé intègre une approche plus humaniste, les enseignements de Racky sont primordiaux.
On parle de syndrôme méditerranéen, de stress, de prises de décisions qui impactent la santé, de posture face aux dérapages et d’ouverture.
Je vous souhaite une très bonne écoute.
🗣️ Au programme :
🎓 Parcours professionnel de Racky Ka Sy (00:00 – 09:46)
🔍 Recherche sur le racisme et l’identité (09:47 – 20:36)
🏥 Le syndrome méditerranéen et racisme en santé (20:36 – 31:15)
🔄 Les stéréotypes dans la pratique médicale (31:15 – 40:44)
⚕️ Formation des soignants et expériences (40:45 – 51:23)
🧠 Sensibilisation et déconstruction (51:23 – 01:00:37)
TRANSCRIPTION DE L’ÉPISODE
Clémentine
Bonjour Racky
Racky Ka-Sy
Bonjour Clémentine
Clémentine
Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Ça fait très longtemps que je suis ton travail et ce que tu fais, donc vraiment merci beaucoup d’avoir accepté de venir dans la Matrescence.
Racky Ka-Sy
Merci à toi pour l’invitation.
Clémentine
Alors on va parler aujourd’hui d’un sujet qui se démocratise et dont tu es un peu la porte-parole et donc je suis contente que tu sois là. Mais avant ça, j’ai quand même envie de m’intéresser à toi. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de devenir psychologue ?
Racky Ka-Sy
Oula, longue histoire. Parce que je m’intéressais beaucoup à la philosophie quand j’étais plus jeune. Donc j’ai fait un parcours scientifique, j’ai fait des maths. Je ne savais pas quoi faire comme beaucoup de jeunes. J’étais perdue à 18 ans après le bac et je me suis dit je vais faire des maths parce que c’est assez simple pour moi donc j’y vais. Mais arrivé en fac de maths, c’était super dur parce que c’était pas du tout concret, plein de chiffres, je ne comprenais rien. Et donc je me réfugiais beaucoup à la bibliothèque et je lisais beaucoup de philosophie parce que j’aimais beaucoup ça.
Et un jour je suis tombée sur un bouquin de psychologie, un manuel de psychologie, et là ça a fait un peu « eurêka » dans ma tête, c’est-à-dire que c’est de la philo, on répond aux questions philosophiques de manière scientifique, ça me correspond tout à fait, donc j’ai décidé de faire la psychologie à ce moment-là. Donc on est en 2002-2003.
Clémentine
Donc ce n’était pas un parcours tout tracé en fait ?
Racky Ka-Sy
Non du tout, j’ai fait deux ans de maths avant d’entrer en psychologie.
Clémentine
Comment est-ce qu’on parlait de la santé mentale quand tu étais plus jeune ? C’était un mot qu’on utilisait déjà ?
Racky Ka-Sy
On n’en parlait pas, on n’en parlait pas du tout. D’ailleurs quand j’ai fait psychologie, ça a surpris beaucoup de monde autour de moi. Tu vois, mes parents, ils viennent du Sénégal, ils ne connaissent pas forcément, donc ils connaissaient les métiers, tu veux pas être médecin, avocat, tu vois, mais psychologue, ça ne parlait pas. Ça ne leur parlait pas du tout. Donc quand j’ai dit que je voulais faire psychologue, tout le monde m’a découragée. Même, ça je l’ai raconté il n’y a pas longtemps sur les réseaux, même la psychologue de la fac de Sergio où j’étais qui m’a dit que ça ne sert à rien de faire de psychologue. Tu seras au chômage, il y a trop de monde. Donc ne fais pas ça. Du coup, je l’ai écouté et c’est pour ça que j’ai retapé mon année, en fait.
Et deuxième année, j’ai dit non non, c’est ça que je veux faire, et là j’écoute personne. Et donc c’est ce que j’ai fait, tu vois. Et non, on ne parlait pas de psycho. Moi ça m’intéressait parce que je m’intéressais à la philo, je ne m’intéressais pas forcément à la psycho. Et ça m’intéressait de comprendre l’esprit humain, comment on fonctionne, répondre à des questions, mais avec l’aspect scientifique en fait.
Clémentine
Donc quand tu découvres tous tes cours de psychologie, tu te dis wow !
Racky Ka-Sy
Oh là là, c’était… J’étais dans mon élément, tu vois. J’ai adoré et j’ai rencontré la psychosociale, parce que je suis aujourd’hui docteur en psychologie sociale, et j’ai rencontré la psychosociale en première année. Je me souviens de mon cours avec Geneviève Coudin, si elle nous écoute, qui est aujourd’hui, il me semble, maître de conf ou professeur à Paris-Cité maintenant. Son premier cours était magique. Je découvre la psychosociale, comment on fait des expériences, on répond à des questions, etc. Donc voilà comment je suis entrée dans la psycho.
Clémentine
Tu ne voyais pas du tout le stigma ou le tabou autour de la santé mentale à cette époque-là ? Parce que c’est vrai qu’aujourd’hui, on commence un peu à lever les tabous et ça devient un sujet dont on peut parler publiquement. En 2000-2002, ce n’est pas encore démocratisé comme ça l’est aujourd’hui.
Racky Ka-Sy
Pas vraiment, mais après quand on est étudiant, je pense qu’on est dans une bulle où on en parle, où il n’y a aucun sujet tabou. Je voyais que certains étudiants étaient quand même un peu mal à l’aise, tu vois. Quand on commençait à parler de Freud, il y en a qui sortaient parce que tellement c’était pas supportable pour eux d’entendre certaines choses. Donc voilà, on développe quand même l’esprit ouvert, critique, mais on est dans une bulle en fait, entre personnes qui s’y intéressent.
Clémentine
Quand est-ce que toi tu t’intéresses à l’impact du racisme dans ta pratique ?
Racky Ka-Sy
Grande question, parce que… Beaucoup d’étapes dans mon parcours. Donc moi, j’ai fait une thèse sur l’effet de menace du stéréotype. Je vais expliquer ce que c’est. La menace du stéréotype, c’est quand on a peur de confirmer un stéréotype négatif associé à son groupe. Un stéréotype, c’est une croyance. Par exemple, les femmes sont sensibles ou elles ne savent pas conduire. À l’époque, elles étaient nulles en maths. Je ne sais pas si on le dit encore, mais un peu.
Clémentine
Si, je crois que c’est encore un peu un stéréotype. Ça se retraduit dans les études de maths qui sont moins utilisées que les hommes.
Racky Ka-Sy
Exact. Et d’ailleurs, moi, quand j’étais en maths, on était cinq filles dans l’amphithéâtre. J’arrivais en psycho, il y a cinq garçons dans l’amphithéâtre. Donc ce sont ces croyances qui sont associées à certains groupes et qui impactent notre manière de percevoir le monde et qui nous impactent aussi nous-mêmes, d’accord. Et si je reste sur le sujet des femmes, on dit que je suis nulle en maths ou que je ne sais pas conduire. Et si je suis dans une situation où on va évaluer mes compétences, par exemple mathématiques, je vais me mettre à la pression, je vais me dire il faut absolument que j’y arrive pour montrer que ce stéréotype n’est pas vrai, qu’il ne s’applique pas à moi parce que je me connais, je sais que je suis intelligente et que je vais y arriver.
Sauf que le fait de mettre la pression, ça prend de la mémoire de travail, c’est une charge en fait, il y a pas mal de pensées parasites et ça m’empêche de réussir mon exercice. Et du coup, je confirme le stéréotype. Donc c’est un cercle vicieux. Il y a plein de stratégies pour l’éviter, mais disons que ça a été mis en évidence aux États-Unis, comme beaucoup de choses dans la recherche, sur les afro-américains, tu vois, auxquels est toujours associé le stéréotype d’incompétence intellectuelle. Et les chercheurs, donc Steele et Aronson pour les citer, puisqu’ils sont très connus, ont démontré que quand on fait passer un test d’intelligence, en mettant, tu vois, un test d’intelligence, les afro-américains performent moins bien que les blancs américains. D’accord ?
Alors que quand on prend le même test et qu’on met une autre étiquette, tu vois, « test de raisonnement », on n’a aucune différence de performance. Donc ce n’est pas une question de performance, c’est une question de situation. Donc la situation va créer un stress, va créer une pression supplémentaire qui va les mener à ne pas y arriver. Pour retourner à ma thèse, moi j’ai fait une thèse sur le sujet. J’ai travaillé sur deux populations, sur les femmes et sur les noires en France. Comment je suis arrivée à la question noire de France ? Ça a l’air évident quand on me regarde, mais alors pas du tout sur le moment, puisque ce n’était pas une donnée forcément importante pour moi. Je sais que je suis une femme noire. Mais c’est tout en fait, c’était pas un frein en soi.
J’ai été très fréquemment la seule personne noire du groupe, du TD, de la promo, donc c’est pas du tout un frein en soi. Mais le contexte en fait dans lequel j’étais en 2010, au début de ma thèse, a fait que c’était un sujet important à ce moment-là. Je ne sais pas si tu te souviens, c’était la coupe du monde en Afrique du Sud et les joueurs ont décidé de ne pas descendre du bus. Donc c’est parti dans les médias, « ce sont des racailles », on a tout entendu en fait sur les joueurs et bien sûr leur origine est ressortie, tu vois. Ce sont des noirs et des arabes donc ils ne savent pas se comporter correctement. Anelka a énormément subi ces stéréotypes-là. Donc il y avait ça.
Et en même temps, en 2010, il y a eu un ouvrage d’un sociologue qui s’appelle Hugues Lagrange, qui a sorti un bouquin sur le déni des cultures. Le bouquin s’appelle « Le déni des cultures ». Et dans ce bouquin, chapitre 1, parce que je pense que beaucoup, je suis désolée, de tes collègues journalistes se sont arrêtés au chapitre 1, où il y a un graphique montrant qu’il y a une corrélation entre origines ethniques et délinquance. Et dans son graphique, tu vois, les jeunes hommes noirs, afro-descendants, les maghrébins, les… Je sais plus s’il a mis les blancs ou les Français, enfin je sais plus. Trois, quatre catégories qui comparaient et on voyait que la barre des personnes noires ou d’origine africaine, subsaharienne, était plus élevée que les autres. Donc, corrélation, sauf que corrélation, ça ne veut pas dire « cause et effet ».
Donc, c’est parti encore une fois dans la presse. « Les jeunes noirs sont délinquants par essence ». Donc c’est là où je me suis dit, tiens c’est intéressant les Noirs comme groupe pour étudier l’effet de menace du stéréotype. J’en ai parlé à mon directeur de thèse qui m’a dit ok. J’avais lu l’ouvrage de Pap Ndiaye qui est devenu notre ministre de l’Éducation. À l’époque il était encore à l’EHESS. Et j’ai lu son ouvrage « La Condition Noire » Et dans son ouvrage, j’ai retrouvé des éléments de menaces du stéréotype. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et donc je l’ai rencontré, il m’a dit que oui, que c’était bien, que c’était intéressant. Il a fait partie de mon jury de thèse par la suite. Et voilà comment je suis arrivée à travailler sur le sujet. Donc au départ, c’est un intérêt intellectuel.
L’effet de menace du stéréotype, je le retrouve chez les personnes noires. Ma thèse démontre que oui, effectivement, les personnes noires vivent des effets de menace du stéréotype tous les jours, du matin au soir. On essaye de ne pas confirmer les stéréotypes, d’arriver à l’heure. Je crois que je suis à l’heure, mais je pensais que j’étais en retard. De s’habiller correctement, de parler doucement parce que si on parle fort, on va nous dire qu’on est agressif, de certains se mettre un peu la pression pour faire des études longues parce qu’on est associé au fait de ne pas faire des études longues et de ne pas être intelligent. Tu vois, il y a plein de… Connaissant tous les stéréotypes négatifs associés au groupe, on essaye de corriger en fait, en permanence ces stéréotypes, donc voilà. Je suis un peu longue là, non ? Ça va ?
Clémentine
Non, non, c’est hyper intéressant.
Racky Ka-Sy
Donc je commence par cette partie recherche. Mais je savais que je ne voulais pas être maître de conférence. J’ai enseigné à la fac pendant cinq ans, c’était génial. Mais c’était pas pour moi, dans le sens où j’ai besoin que ça bouge, j’ai besoin que… La psychosociale, c’est une discipline géniale. Je suis tombée deux pieds dedans. Je suis encore dedans. Et c’est une discipline qui explique, qui a des outils pour expliquer ce qui se passe dans la société. Et je trouve ça dommage qu’on soit enfermés entre nous, entre chercheurs, dans nos colloques, dans nos… Ouvrages avec nos étudiants, on se parle entre nous, alors que tu allumes la télé, tu entends un débat et puis t’as toujours un historien, un sociologue, un politologue, un je sais pas quoi, qui est invité et jamais un psychologue social, qui a les outils en fait pour expliquer.
Et donc je poursuis et je suis devenue à un moment donné consultante. Ouais, consultante, on faisait diversité à l’époque. Je crois qu’on utilisé beaucoup le terme « diversité », un peu le terme « inclusion », mais pas vraiment. Et j’ai fait des formations, en fait, pour des professionnels. Je ne sais pas si je peux citer, mais non, des grandes entreprises, des institutions françaises où on allait, en fait, dans les salles de réunions, on faisait des formations sur comment on arrive à la discrimination, parce qu’il y a tout un processus qui nous mène à la discrimination. Donc j’ai fait ça, et à un moment donné, j’ai eu envie de me rapprocher des gens. Parce que j’ai mon titre de psychologue, mais les psychologues sociaux ne sont pas…
Clémentine
En cabinet ?
Racky Ka-Sy
On n’est pas fait, a priori, pour être en cabinet, parce qu’on est sur des sujets sociétaux, donc certes on est sur les liens entre l’individu et le groupe, tu vois, mais pas forcément pour faire de la thérapie individuelle. Mais bon, j’avais envie de le faire et je l’ai fait. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, j’ai ces trois casquettes de chercheuse, je fais de la formation, je fais de la sensibilisation jusqu’à présent et je fais de la thérapie.
Clémentine
En fait, depuis ta thèse, toute ta pratique est centrée autour, ducoup du racisme et ses conséquences sur l’individu et le groupe.
Racky Ka-Sy
Exactement. Donc je travaille sur le même sujet, à différents niveaux, avec différents acteurs. Donc tous ces éléments se nourrissent les uns les autres. Le fait d’avoir des patients, à un moment donné, qui me racontent des situations de harcèlement ou de discrimination, je vois ce que ça fait sur l’individu. Et ensuite, quand je fais de la formation, de la sensibilisation, j’utilise ces cas pour expliquer les conséquences. Plus, l’aspect recherche qui me permet aussi d’expliquer.
Clémentine
Tu peux personnifier des chiffres qui se traduisent dans des cas pratiques, concrets. Alors le racisme, on sait, c’est partout, dans toutes les couches de notre société, comme le sexisme, comme le validisme, comme beaucoup de problématiques sociales aujourd’hui. Et le domaine de la santé n’est pas épargné du tout par cette problématique de racisme. Est-ce que tu peux nous parler du « syndrome méditerranéen » et de ses conséquences ?
Racky Ka-Sy
Oui, alors tu fais bien de rappeler que le racisme imprègne toute la société, d’accord ? Et quand on parle de racisme, en tout cas moi quand j’en parle, je parle de cette forme de racisme qui a existé depuis les 400 dernières années, d’accord ? Parce que de tout temps les êtres humains se sont fait la guerre, dans tous les sens, d’accord, donc on ne va pas remonter jusque-là, mais sur les 400 dernières années, donc esclavage, colonisation, etc. Donc on parle de ça, on parle de la hiérarchisation des groupes humains, c’est-à-dire le fait de penser, de dire, d’affirmer, et de faire en sorte que le groupe dominant soit le groupe des personnes blanches. Les groupes dominés sont tous les autres, y compris les personnes noires. Et ce système-là, on le retrouve partout. Partout économiquement, politiquement… Tu prends n’importe quel sujet, le logement, l’école…
La justice, peu importe, tu trouveras toujours les mêmes inégalités. Et la santé n’est pas épargnée, puisque dans le système de santé, on a des personnes qui vivent quand même dans la société et donc qui sont imprégnées de ces croyances. Même si tout le monde se dit « moi je ne suis pas raciste, j’aime tout le monde ». Oui, c’est bien.
Clémentine
On est tous racistes.
Racky Ka-Sy
C’est-à-dire qu’on connaît tous, les théories racistes. On les connaît. Peut-être qu’on y adhère sans le savoir. On fait des choix qui les confirment. Donc, on est imprégné. On vit dans une société. Donc, dans la santé aussi. Alors pour revenir à ta question, qu’est-ce que c’est le syndrome méditerranéen ? Récemment j’ai fait, pardon petite parenthèse, une interview radio chez RFI. Ils ont pris juste cet extrait où j’explique ce qu’est le syndrome méditerranéen. Et c’est parti en… Il y a eu énormément de commentaires de personnes qui n’étaient d’accord et pas d’accord.
Clémentine
Ah oui, en fait on n’est pas là pour être d’accord ou pas d’accord, tu vas nous expliquer ce que c’est.
Racky Ka-Sy
Alors, le syndrome méditerranéen, c’est un biais raciste, d’accord, qui consiste à penser que les personnes originaires du pourtour méditerranéen, on peut descendre jusqu’à l’Afrique subsaharienne, exagèrent l’expression de leur douleur, d’accord, que lorsqu’une femme, je dis une femme parce que c’est souvent associé aux femmes, mais on peut aussi penser aux hommes, Lorsqu’une femme exprime sa douleur, on part du principe qu’elle exagère. Elle n’a pas si mal que ça. Et donc comme elle n’a pas si mal que ça, et qu’elle exagère, elle me casse les oreilles, je ne vais pas lui donner de médicaments pour la soulager, etc. C’est ça le syndrome méditerranéen, mais on a aussi le syndrome transalpin, par exemple, en Suisse, où on estime que les personnes originaires d’Italie, etc. Exagèrent.
Le racisme, c’est aussi ça, c’est-à-dire que le dominant dans une société donnée estime que les personnes dominées ou assimilées à une position dominée sont moins bien, exagèrent, et derrière tout ça, on a la déshumanisation. Ils ne sont pas vraiment humains. Si elle exagère, c’est qu’elle ne ressent pas vraiment la douleur. Donc tout au bout, quand on gratte un peu, on a la déshumanisation.
Clémentine
Oui, la première conséquence c’est ça. Parce qu’en fait, il faut avoir conscience que le syndrome méditerranéen malheureusement tue.
Racky Ka-Sy
Oui.
Clémentine
On l’a vu dans les médias ces dernières années. Des femmes noires, souvent, qui appellent le SAMU et qui ne sont pas écoutées et qui vont mourir dans d’atroces douleurs parce qu’elles n’ont pas été transférées. Donc c’est la déshumanisation, c’est la croyance en exagération et c’est l’incapacité à entendre en fait.
Racky Ka-Sy
Oui, oui. Le manque d’empathie et donc une prise de décision. Quand tu parles de ces cas, par exemple le cas de la petite Aïcha ou le cas de Naomi Musenga ou le cas de Meggy, il n’y a pas longtemps. Il y a aussi plein d’autres cas. Qui existe, c’est une succession de décisions. Dans le cas de la petite Aïcha, par exemple, ce sont les pompiers, d’abord le SAMU et peut-être les pompiers, qui, enfin je ne sais pas s’ils ont appelé le SAMU, pardon, je me trompe peut-être. Mais les pompiers qui sont venus et qui ont passé 30 minutes chez eux, à dire qu’elle exagère en fait. Alors que s’ils avaient pris ces 30 minutes-là, s’ils avaient raccourci et décidé de l’emmener directement à l’hôpital, qu’elle fasse ses examens, peut-être qu’elle aurait pu être sauvée. Donc c’est une succession, de décisions par des personnes qui sont imprégnées de cette idéologie raciste. J’ai aussi écouté récemment le cas d’une autre dame qui est décédée d’une crise cardiaque, mais qui était déjà allée voir les urgences la veille, pendant la nuit, et elle appelle en fait le SAMU. Et la dame du SAMU, d’abord la dame et puis, ensuite un monsieur, enfin ensuite le médecin du SAMU, qui lui dit « Madame, vous prenez quoi comme médicament ? » Mais la dame elle a mal, tu vois, elle ne sait pas « Attendez, je cherche » et puis il s’énerve, il insulte. C’est des gros mots quoi. Et tu vois, elle a un accent cette dame, elle a un accent antillais. Parce que ça aussi ça joue, c’est-à-dire que quand j’appelle le SAMU, qu’est-ce qu’ils savent de moi ? Il y a peut-être le nom, le prénom, l’âge et l’accent.
Donc elle a l’accent antillais, accent antillais, personne noire, donc tu vois l’enchaînement ? Donc forcément soit elle exagère, soit j’ai pas envie en fait, de lui parler finalement, je veux m’en débarrasser le plus rapidement possible. Et donc voilà comment, je disais, il y a une succession de prises de décisions, donc lui estime que oui, qu’elle exagère, etc. Donc finalement, on leur envoie un camion du SAMU, sauf qu’on ne lui envoie pas le camion qui permet le déchocage, la prise en charge d’un malaise cardiaque, on lui envoie un camion simple. Et en plus, c’est qu’ils sont venus super tard et la dame est décédée dans sa cuisine.
Clémentine
Ça tue. Non mais voilà, c’est la réalité de ça. C’est que là, tu cumules sexisme et racisme.
Racky Ka-Sy
Exact
Clémentine
C’est une double sanction pour des femmes qui subissent ce syndrome méditerranéen, dans ces proportions-là. Moi, ça m’intéressait vraiment de parler de ce sujet avec toi parce que, en tant que parent, on est confronté à la santé en permanence, plus que n’importe qui d’autre, à amener nos enfants chez des médecins, ou simplement parce qu’on a eu affaire à des sage-femmes, on a été enceinte et on a côtoyé le milieu hospitalier bien plus que dans une vie d’adulte classique. Et donc, ça a un impact aussi sur les futures mères et sur les mères. Tu formes aujourd’hui les futurs médecins, aux côtés de Priscille Sauvegrain qui a fait sa thèse sur les sage-femmes, la prise en charge des femmes africaines pendant leur grossesse. Tu fais ça, je crois, depuis 2023.
Racky Ka-Sy
Oui, depuis trois ans à peu près.
Clémentine
Trois ans à l’université de la Sorbonne. Pourquoi est-ce que tu as voulu aller former les soignants ?
Racky Ka-Sy
Parce que c’est important. C’est important de former les soignants. Parce que, alors, je travaille sur l’impact du racisme et des discriminations sur la santé. Et quand je dis ça, ça recoupe plein de sous-parties. Il y a des personnes dont la santé est impactée parce qu’elles ont vécu des situations de discrimination ou de racisme au travail ou dans la vie en général, et donc ça impacte leur santé mentale et leur santé physique. Et ces personnes-là, généralement, quand ça ne va pas trop, elles vont voir leur médecin traitant. Donc le médecin traitant est le premier ou la première à avoir un dialogue ouvert sur le sujet. Quand les personnes ne vont pas bien, qu’elles ont mal au ventre, mal à la tête, elles vont voir le médecin. « Docteur, j’ai mal à la tête. » Et le médecin peut s’arrêter là.
Sauf que, en les formant, justement, avec ce qu’on essaie de faire avec Priscille, on élargit le champ des possibles et on complexifie un petit peu la situation et on met la lumière sur le racisme et les discriminations que peuvent vivre les patients racisés en France. Non seulement c’est utile pour eux pour mieux comprendre le patient et ce qu’il a vécu, mais c’est aussi important pour eux en tant que praticiens. Parce qu’on vient de parler du syndrome méditerranéen, ils prennent des décisions, peut-être pas le médecin traitant, mais si, tout le monde prend des décisions à longueur de journée. Et à l’hôpital notamment, les décisions prises peuvent avoir un impact vital, enfin ont un impact vital. Récemment on m’a demandé pourquoi… Est-ce que le champ de la santé est différent des autres champs que vous étudiez ? Oui et non.
Non sur le principe, c’est-à-dire que l’idéologie raciste imprègne tout le monde, donc non. Mais la santé est particulière parce que c’est une question de vie et de mort en fait, c’est tout. Donc on intervient à l’université de la Sorbonne, je suis intervenue aussi à Paris Cité. Demain, je vais à Lyon, donc je vais intervenir là-bas aussi. Et l’objectif est de les sensibiliser, de leur donner du contenu, de leur expliquer de quoi on parle en fait. Puisque si je m’arrête au syndrome méditerranéen, on peut dire bon ben c’est peut-être passé parce que c’est plus du tout présent dans les livres de médecine, mais ça se dit encore en fait dans les services. Et les jeunes générations sont un peu plus, je dirais, ouverts d’esprit, plus tolérants. Donc on peut s’arrêter là et dire je n’y adhère pas donc ça risque pas de m’arriver.
Sauf que ce n’est pas que ça en fait, sachant qu’en plus à l’hôpital on n’a pas beaucoup de temps, on prend des décisions rapidement et je parlais des stéréotypes tout à l’heure, beh ils s’activent très rapidement dès que tu vois une personne, tout ce que tu sais sur les catégories auxquelles elle appartient, tu vois, ça active. Tu vois une personne, bon, elle est de quelle couleur, c’est une femme, c’est un homme, de quelle catégorie sociale elle est-ce qu’elle parle bien, est-ce qu’elle ne parle pas bien… Tous ces indicateurs te donnent une impression et ces impressions vont t’influencer dans la manière dont tu vas prendre en charge la personne. Donc, je ne sais plus quelle a été ta question, mais…
Clémentine
Qu’est-ce que tu leur enseigne, en fait, à l’université ?
Racky Ka-Sy
Qu’est-ce qu’on leur enseigne ? Alors, on leur enseigne plein de choses. Moi, j’ai vraiment ma casquette de psychologue sociale, tu vois, qui explique les choses. Comment passent des croyances, des stéréotypes, des préjugés, aux discriminations. Comment on décortique, en fait, tout ça. D’où ça vient, historiquement. Parce qu’historiquement, il y a des liens entre racisme et médecine. Puisque la médecine, telle qu’on la connaît aujourd’hui, a beaucoup expérimenté sur des corps non blancs. Des corps de femmes, des corps de personnes en situation de handicap, etc. Donc, l’histoire de la médecine, on y fait aussi référence. On parle également de… Là je parle du syndrome méditerranéen mais il y a pleins d’autres choses également, de comment concrètement ces stéréotypes, ces préjugés, impactent et comment ils se manifestent en fait dans le quotidien.
Dans leurs pratiques et l’impact sur les patients, au-delà de l’impact sur la santé mentale, sur la santé physique, parce qu’il y a des personnes qui peuvent aussi développer des maladies à force de faire face à des situations de racisme et de discrimination. Également à l’impact de la prise de décision sur la qualité de la prise en charge, sur les soins prodigués. Il y a des recherches, on parlait tout à l’heure de recherche, est-ce que c’est possible ou pas possible ? Oui c’est possible, il y a des recherches, il y a quelques contenus en France. Montrant par exemple en psychiatrie qu’il y a une étude, je crois que c’est de Marguerite Cognet, qui montre qu’en psychiatrie, les hommes noirs et arabes sont moins bien traités que les hommes blancs.
Donc il y a aussi du verbatim, c’est-à-dire que disent les médecins, que disent les soignants de ces patients-là ? On les entend dire ça. Ils sont plus contenus que les autres. Ils sont plus victimes d’injections que les autres. Avec l’idée qu’ils sont dangereux. Ils sont dangereux donc il faut les contenir tout de suite. Alors que d’autres on va dire qu’ils sont dangereux mais bon… Encore cette déshumanisation. S’ils ne sont pas humains, ça reste des objets. Donc on va essayer de les contenir, on va essayer de les écarter. Alors que quand tu es humanisé, tu restes un agent. Parfois on te pose la question, on te rend acteur de ta santé, alors que quand tu fais partie de ceux qu’on déshumanise, tu ne l’es pas du tout.
Clémentine
En tant que femme déjà, on est souvent déshumanisés dans la santé quand même, malheureusement. C’est mieux, mais il y a quand même encore malheureusement cet aspect-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les stéréotypes pour les femmes enceintes, par exemple, autour de l’accouchement vis-à-vis des personnes racisées ?
Racky Ka-Sy
Les femmes enceintes, déjà sur la douleur, c’est qu’elles exagèrent, mais il y a d’autres stéréotypes qui ont l’air positifs, c’est-à-dire sur l’allaitement par exemple. Elles savent faire. Elles savent faire, donc on ne va pas forcément prendre le temps de leur expliquer. Est-ce qu’il y a d’autres croyances ? Je crois que Priscille répondrait mieux que moi sur la question, mais il y a tous les stéréotypes qu’on connaît.
Clémentine
Elles savent accoucher, elles savent faire, ou il faut les déclencher je crois.
Racky Ka-Sy
Oui, il y a d’autres études, je pense de Priscille qui montrent que les femmes noires sont les plus césarisées que les femmes blanches. Parce que si elles savent accoucher, pourquoi est-ce qu’elles sont plus césarisées ? Parce que les stéréotypes et les préjugés, ce sont des pièges, en fait. C’est-à-dire que je pense que ces femmes-là savent accoucher. Donc je m’attends à ce que ça se passe bien. Et aux moindres grains de sable, ça ne se passe pas bien, c’est panique à bord, donc elle ne correspond pas. Je pense que la décision de césariser est quand même plus réfléchie que ça. Mais disons qu’elle est un peu aussi alimentée par le fait que si elle ne correspond pas à mes attentes, c’est qu’il doit y avoir un problème très grave ou tellement grave qu’on doit faire une césarienne tout de suite.
On ne lui donne pas, on ne lui laisse pas la possibilité de… Je ne sais pas, d’être dans un autre… Je dirais dans un autre « mood », enfin c’est le seul mot qui me vient, pour accoucher, puisque l’accouchement c’est aussi beaucoup psychologique. J’ai trois enfants, donc j’ai déjà accouché. Et je sais que le psychique influence beaucoup sur… J’ai vu toi aussi tu as accouché aussi de manière naturelle à la maison. La préparation est extrêmement importante. Et donc en tant que sage-femme, en tant que personnel soignant, si tu abordes ta patiente en disant… Qu’est-ce que tu lui donnes en fait comme énergie ? Est-ce que tu estimes qu’elle sait faire et donc tu n’as pas besoin d’être là ? Sauf que si elle n’a pas été accompagnée, si elle est loin de sa famille, elle ne sait peut-être pas en fait. Donc elle a besoin de toi.
Et donc tu vas prendre tes décisions en fonction de ces appréhensions-là et dans ce qu’on leur apprend aux étudiants, c’est comment concrètement dans leur pratique ils peuvent éviter de tomber dans ces pièges-là.
Clémentine
Alors il y a quoi qu’ils peuvent faire, par exemple ?
Racky Ka-Sy
La question de la confiance est importante. Comment est-ce que j’arrive à montrer que j’ai confiance en mon patient ? Et que je le considère, la considère comme humain, humaine avant tout. Donc un peu laisser de côté mes préjugés, mes stéréotypes, en prenant le temps. Par exemple, prendre le temps, c’est un conseil. Prendre le temps, même si c’est difficile de prendre le temps, mais disons que comme ces éléments s’activent tout de suite, il faut que je puisse m’en détacher. Il faut que j’arrive à accéder à une forme de complexité de la personne que j’ai en face de moi. Et donc il faut que je lui parle en fait. Parce que quand tu parles à une personne, tu finis par dire « ah mais », je pense que t’as déjà entendu ça ou nos auditeurs et auditrices ont déjà entendu ça. « J’aime pas les X mais toi je t’aime bien ». Tu vois.
Clémentine
Red-flags on dit.
Racky Ka-Sy
Mais pourquoi la personne dit ça ? Elle dit ça parce que, elle a accédé à une forme de complexité, c’est-à-dire que tu n’entres plus dans les cases. Une fois qu’on a compris que oui, peut-être que tu sais bien faire à manger, peut-être que tu es chaleureuse, peut-être que tu as beaucoup d’enfants, mais en même temps tu es plein d’autres choses qui te font sortir des cases. Donc l’objectif c’est ça, c’est de faire sortir les gens des cases et pour ça il faut leur parler, il faut créer une relation de confiance et une complexité. Et j’ai une médecin généraliste avec laquelle je travaille justement qui a… Ça peut prêter à sourire mais ça impacte la confiance, elle utilise des pansements de couleurs différentes.
Clémentine
Pourquoi ça vous prêterait à sourire ? C’est tellement incroyable que ça n’ait pas été le cas avant, que ce ne soit que pour des peaux blanches.
Racky Ka-Sy
Oui, certains diraient « oui mais c’est que des pansements ». C’est que des pansements mais quand même, ça veut dire que tu vois la personne entièrement. Et ça crée des éléments de confiance. Oui, en fait, c’est ça.
Clémentine
En fait, c’est encore ce que tu disais, c’est de les réhumaniser, pour les sortir de la case dans laquelle notre cerveau, à force d’avoir écouté des choses, vu des choses, d’être élevé dans tel type de société, associe cette personne-là. Et quand on humanise quelqu’un, on fait tomber les barrières, c’est ça ?
Racky Ka-Sy
Exact.
Clémentine
Et du coup, on est beaucoup plus à l’écoute. Mais ça m’interpelle dans ce que tu dis, parce que ça voudrait dire aussi qu’il faut que ce soit une médecine qui a le temps.
Racky Ka-Sy
Oui, ça c’est la barrière la plus importante. Une médecine qui a le temps et qui a les moyens. On sait dans quel état notre système de santé est, c’est tellement catastrophique. Là on essaye un peu de sauver les meubles donc prendre le temps de penser à ces sujets là, ça arrive peut-être de manière secondaire. Mais il faut une médecine qui a le temps. Les sage-femmes généralement ont le temps. Mais ce n’est pas toujours le cas quand on travaille dans un hôpital.
Clémentine
Après, les sage-femmes ont le temps, mais quand elles sont sous-effectives dans un service de maternité, malheureusement, elles n’ont pas forcément le temps.
Racky Ka-Sy
Je pensais à ma sage-femme en cabinet.
Clémentine
En cabinet, je suis d’accord que c’est différent, mais c’est vrai qu’un accouchement, ça peut être du stress, ça peut être un moment où il faut prendre vite des décisions. Et de ce que tu dis, s’il y a déjà des stéréotypes bien imprimés qu’on ne prend pas le temps, On peut vite se dire, « vu qu’elle, j’ai catégorisé femme africaine, elle sait accoucher donc je vais laisser toute seule gérer et moi je vais m’occuper des autres ». Sauf qu’en fait cette femme-là, elle est peut-être en souffrance, il y a peut-être un problème, elle a juste besoin d’humanité et d’être accompagnée. Ça se matérialise comme ça, finalement. C’est insidieux parce que c’est compliqué de dire là c’est du racisme.
Racky Ka-Sy
Absolument. C’est la question qu’on me pose le plus souvent. Comment savoir si c’est du racisme ou pas ? C’est super compliqué de savoir. Et les catégories en soi, catégoriser, utiliser des stéréotypes, c’est pas quelque chose de… De mal dans le sens où notre cerveau le fait automatiquement et qu’on en a besoin. On a besoin de catégoriser pour aller vite parce que notre cerveau traite un milliard d’informations à la minute. Déjà ce qui se passe dans notre corps, plus l’extérieur, etc. Donc on a besoin de catégoriser, on a besoin de stéréotyper, on a besoin d’aller vite, surtout en médecine. Donc les catégories, elles peuvent être utiles. Le problème, c’est la conséquence, le résultat, à la fin.
Et si catégoriser la personne c’est une justification pour moins bien la prendre en charge, pour ne pas lui donner de médicaments par exemple, pas lui donner d’antidouleurs, pour la traiter moins bien que les autres, alors là oui, on tombe dans une forme de racisme. Mais utiliser ces catégories pour soigner tout le monde de la même manière, ou en tout cas que le résultat soit le même pour tout le monde, ok. Si à un moment donné on doit corriger certaines différences qui sont dues soit à une origine culturelle ou géographique ou autre, parce que ça arrive en médecine, pourquoi pas ? Pour moi, c’est ce que je dis aux étudiants, la boussole ça doit être le résultat, ça doit être la conséquence.
Clémentine
Est-ce que tes étudiants, ça leur arrive parfois dans ton cours, donc tu me disais que c’est les sixièmes années, qui ont déjà la capacité d’être face à des publics là où ils sont internes, est-ce que des fois ils tombent des nues ? Ils n’avaient jamais compris comment ça marchait, ou jamais entendu parler, ou vraiment tu leur apportes des infos auxquelles ils n’avaient jamais eu accès avant ?
Racky Ka-Sy
On leur apporte des explications de ce qu’ils ont déjà vu, parce que bien souvent ils ont déjà vu, déjà expérimenté, et pendant le cours on a énormément de témoignages de personnes, et ils n’hésitent pas à prendre la parole, à raconter soit une expérience en stage, soit une expérience personnelle, Mais ce qui arrive, que ce soit chez les étudiants ou chez d’autres publics en fait, quand j’interviens sur ce sujet-là, c’est une prise de conscience des personnes concernées, mais qui ne savaient pas en fait mettre des mots sur ce qu’elles vivaient, et qui ne savaient pas à quel point, tu vois, c’était… Que leur vie était impactée, à quel point leur vie était impactée.
Clémentine
Tu veux dire que ce seraient des étudiants et étudiantes racisés ?
Racky Ka-Sy
Oui, étudiants et étudiantes racisés ou autres. Je pense à une intervention que j’ai faite chez des enseignants et même là chez les étudiants l’année dernière. Ça arrive souvent que les personnes racisées soient juste bouleversées en fait, de ce qu’elles viennent d’entendre. Donc on a les deux. Il y a ceux qui prennent conscience, ceux qui ne prennent pas conscience et qui se fichent du problème, je ne les entends pas. Donc jamais personne n’est venu me voir en me disant « je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites ».
Clémentine
« C’est pas vrai ».
Racky Ka-Sy
« Vous exagérez, c’est pas vrai ».
Clémentine
« Vous parlez trop fort, vous exagérez, c’est pas vrai ». On vient de confirmer tous les stéréotypes.
Racky Ka-Sy
Jamais, jamais. Je n’ai jamais eu ça, même sur les réseaux, jamais. Des débats, rien de grave. Et donc, une compréhension de ce qui se passe, plein d’exemples, et des personnes qui sont bouleversées parce qu’elles se rendent compte de ce qu’elles vivent.
Clémentine
Est-ce que tu as du coup des médecins, comme tu disais, la jeune génération, ils sont plus ouverts, ils sont plus curieux de faire au mieux pour leurs patients et patientes. Est-ce qu’ils viennent te voir en te demandant comment je fais dans cette situation ? Est-ce qu’ils ont des questions concrètes parce qu’ils sont démunis et parfois Tu sais, parfois ça nous arrive à tous de faire passer un message et il est mal passé. On l’a mal exprimé, c’est perçu comme quelque chose de raciste. Que tu donnes cet exemple de quelqu’un qui demanderait l’origine ethnique de la personne, pas parce que ça l’intéresse dans sa vie personnelle, mais parce que ça a des conséquences sur sa santé. Est-ce qu’ils sont confrontés à ces interrogations-là ?
Racky Ka-Sy
Oui, c’est la question qui revient le plus souvent. Comment je fais concrètement quand je suis en stage et que je vois des choses inacceptables, comment je fais ? Sachant que quand t’es étudiant, quand t’es stagiaire, bah t’es un peu en position de vulnérabilité. Tu veux quand même valider ton stage, tu veux pas te mettre à dos les chefs, les supérieurs, etc. Et même les collègues. Donc c’est délicat de dire quelque chose. Et moi je conseille… Alors la première chose c’est faites ce qui vous convient le mieux. C’est-à-dire qu’on n’est pas toujours obligé de réagir. Parce que si réagir c’est coûteux pour vous, émotionnellement, intellectuellement, et même au niveau de… Administrativement. Si c’est coûteux, ne le faites pas. Si c’est trop coûteux pour vous, à ce moment-là, il vaut mieux se préserver. Utilisez la stratégie qui vous correspond le mieux.
Et une des stratégies, la plus simple qui existe, je pense, c’est juste de poser la question. Pourquoi dites-vous que Madame un tel accouche bien ? Enfin, je veux dire, elle est en train d’accoucher là, donc on sait pas encore déjà. Pourquoi ? Interrogez-le. Juste posez la question du pourquoi. Parce que ça va pousser la personne à expliciter ses stéréotypes. « Ces gens-là, ils accouchent bien. Ces gens-là exagèrent ». On les connaît. Qui on ? Et qui en fait ? Vous connaissez cette personne ? « Oui mais non, mais ils sont tous pareils ». À bon ? Quelle est l’étude scientifique qui démontre, et c’est l’une des caractéristiques des stéréotypes, ils sont indémontrables. Quelle est l’étude scientifique qui démontre que, puisque ça m’intéresse, j’aimerais bien les lire ? Est-ce que vous pouvez m’expliquer ?
Tu pousses la personne à expliciter et là, t’as une chance qu’il y ait une petite lumière qui s’allume en disant soit elle ne vous répond pas, soit il y aura un dialogue.
Clémentine
Soit une prise de conscience. Oui, c’est sûr que les étudiants et étudiantes doivent être confrontés encore à une forme de racisme assez décomplexé parfois dans les institutions médicales, le monde hospitalier. Et quand c’est eux, tu vois, qui ont affaire à une personne racisée et qui ne savent pas comment aborder parce qu’ils ont peur d’être perçus comme quelqu’un de raciste, mais ils doivent demander des questions aussi sur l’origine ethnique pour peut-être une maladie particulière qui est réelle. Il y a des ethnies où il y a des maladies associées à leur génétique. Qu’est-ce que tu leur dis ?
Racky Ka-Sy
Mais tant que la question est justifiée, il n’y a aucun souci. C’est-à-dire, « je vous demande ça parce qu’on a observé que les personnes qui viennent de cette région du monde ont telle ou telle maladie. Donc est-ce que vous pouvez m’expliquer ou est-ce que vous pouvez répondre à ces questions ? » Je veux dire, les personnes, c’est comme la question d’où viens-tu ? Les personnes en soi, on n’a aucun souci à répondre à cette question. Le problème, c’est l’insinuation derrière. Quand on te pose la question d’où viens-tu, mais qu’on te la pose quatre fois, déjà cinquante fois dans la journée, et que quand tu réponds, « beh je suis Picarde », moi je suis Picarde, hein, je viens des Hauts-de-France.
Clémentine
T’as pas l’accent, ça va.
Racky Ka-Sy
Mon père a l’accent.
Clémentine
Tu l’as lissé à Paris.
Racky Ka-Sy
C’est marrant ça ! La question c’est pourquoi est-ce que tu t’arrêtes pas à ma réponse ? C’est à moi de décider comment est-ce que je veux me présenter au monde en fait. D’où viens-tu ? Si je te dis que je viens de Picardie ou de machin… Ça devrait suffire, tu vois. Mais si je veux en dire plus, j’en dirai plus, tu vois. Et ce qu’on ne supporte pas, c’est cette suspicion de « mais t’es pas vraiment française en fait, tu viens d’où vraiment parce que j’ai vraiment envie de savoir ». Ok, mais pourquoi tu veux savoir ? Donc c’est ça. Mais dans le monde médical, déjà c’est un monde particulier et je pense que quand on pose des questions c’est pas pour rien.
Donc les gens quand ils sont là, ils sont en souffrance et ils viennent pour être soignés, donc a priori le médecin recueille toutes les informations nécessaires et juste le fait d’expliquer en fait, ça suffit.
Clémentine
Est-ce que c’est récent le fait que la médecine s’intéresse à ce sujet-là ?
Racky Ka-Sy
Ouais, ça fait trois ans. Il n’y a pas de cours, jusqu’à notre cours il y a trois ans, il n’y a pas encore de cours établis dans le programme français sur ce sujet-là. En psychologie non plus, on peut en parler, mais moi j’ai découvert la question raciale après, en thèse. Parce que pendant toutes mes années d’études, On nous parlait de plein d’auteurs en psychologie, Broca par exemple, l’ère de Broca, l’ère du langage. Nos enseignants nous parlaient de la partie recherche en psychologie, de l’apport en fait de ces auteurs en psychologie. Sans jamais mentionner les contributions racistes, en fait. Alors qu’il y a deux ans, l’APA, l’Association américaine de psychologie, a reconnu officiellement l’impact de la recherche en psychologie et des psychologues et toutes les pratiques dans la perpétuation des idées racistes. Oui, c’est fort. Dans la perpétuation, le maintien, la diffusion des idées racistes. Donc c’est assez récent.
Clémentine
Des fois quand les Américains donnent l’impulsion, ça vient.
Racky Ka-Sy
J’espère, mais en psycho je n’ai rien vu. Pour l’instant, oui.
Clémentine
Parce que tu disais, tu l’abordes comme n’importe quel autre sujet, mais la santé, il y a un enjeu de vie derrière. Il y a aussi des traumatismes qui vont être forts pour, je ne sais pas, un exemple de parents qui sont avec leurs enfants face à des médecins qui ne vont pas les écouter et leur enfant va souffrir, on ne va pas détecter leur… Leur maladie. Ça me paraît aberrant que ton cours soit dans une université et que t’ailles ponctuellement voir… Et en plus c’est que les médecins, tu ne vas pas dans les autres professions.
Racky Ka-Sy
Pour l’instant non. Parce que là on parle de la santé. Donc tous les corps de métier sont concernés. Après moi je fais des formations moi, face à des professionnels de santé qui viennent de leur plein gré, qui passent… On fait un an, en fait, sur un an, on fait deux jours intensifs de contenu, de mise en situation, etc. Et pendant un an, je les suis en supervision, tu vois, où justement, ils peuvent apporter les situations rencontrées à l’hôpital, au cabinet, et on décortique, on essaie de voir quelle est la meilleure réponse à apporter. J’ai étudié le sujet mais je ne suis pas experte de tout non plus, donc il y a encore des choses que je découvre, il y a encore des subtilités à apporter sur tout ça.
Clémentine
Est-ce que tu aurais une histoire qui te vient à l’esprit d’un truc hallucinant et qu’un étudiant ou une étudiante t’ait raconté dans les situations où ils ont été confrontés face à ça en santé ?
Racky Ka-Sy
Je crois que celle qui m’a… Il y en a une qui m’a un peu marquée, c’est celle sur une femme… Je crois que je l’ai entendue dans un podcast, mais c’était d’une étudiante qui était dans notre cours. Elle est en maternité, il me semble, et c’est une maman migrante. Qui arrive et qui accouche. Et pendant des jours qui suivent, la maman ne porte pas trop le bébé. Elle a les volets fermés, elle ne mange pas, on apporte son plateau, il repart tel qu’il est venu. Elle ne parle pas beaucoup. Et les soignants l’expliquaient par « Oh mais ces gens-là… » Encore les catégories. Sans forcément essayer d’humaniser. En fait c’est ça, c’est un piège dans le sens où on n’humanise pas, on met à distance la personne. Et personne ne s’est vraiment posé la question de, est-ce que cette maman va bien ? Est-ce que dans son…
Je me rappelle bien, on expliquait le fait que peut-être que dans son pays c’est comme ça, on ne porte pas forcément le bébé. En plus, c’est en totale contradiction avec l’idée que les femmes africaines seraient de bonnes mères, etc. Mais personne n’a pris l’initiative d’aller la voir et demander si elle allait bien. Et cette maman était en train de faire une dépression. Et j’ai trouvé ça hyper triste. Elle a passé le parcours, il me semble, par la Libye, le parcours migratoire par la Méditerranée, elle est arrivée ici, et elle se retrouve dans un pays qu’elle ne comprend pas forcément, une langue qu’elle ne connaît pas forcément, et personne ne vient lui demander comment elle va. Et l’étudiante, justement, qui nous raconte ça, nous dit que justement, elle est partie la voir, essayer de lui parler, essayer de…
Tu vois, ils essayent aussi d’apporter du contenu en réunion d’équipe, d’interroger, de parler pour la personne. C’est comme ça que ça va changer. Enfin, je veux dire, les gens ne vont pas changer tout seuls. Il faut qu’ils rencontrent en fait le sujet à un moment donné et soient en cours. Donc là, c’est ce qu’on essaie de faire avec les futurs médecins. Mais aussi dans les hôpitaux, dans leur service, avec quelqu’un qui va apporter le sujet, qui va soulever des questions. Parce que sinon, il n’y a rien qui change, de toute façon.
Clémentine
Et c’est intéressant ce que tu dis, parce que les stéréotypes, c’est quand ça les arrange. Tu vois, quand tu dis ça va à l’encontre du stéréotype des femmes africaines qui savent gérer comme il faut, elles sont maternantes, mais en fait, quand il faut les aider, il n’y a plus personne.
Racky Ka-Sy
En fait, c’est un piège, c’est-à-dire que, je crois que j’ai utilisé ce mot plusieurs fois, mais c’est vraiment ça, c’est-à-dire qu’à la fois… J’hésite, je vais peut-être le faire, mais parler de mon expérience personnelle, mon troisième accouchement où j’ai passé la nuit à l’hôpital, ça allait, j’ai marché, j’ai une super sage-femme magnifique qui m’a préparée psychologiquement, tu vois. Et je tombe sur une sage-femme, une jeune, qui n’arrivait pas vraiment à m’examiner, donc on s’est dit, allez marcher, prendre un bain, machin. Et au petit matin, elle me dit, mais je pense pas que ce soit pour aujourd’hui. Et moi, je commençais à avoir mal. Et je demande un calmant. Elles ont fini par me le donner, mais vraiment à contrecœur. Et on m’a dit, rentrez chez vous, c’est pas pour aujourd’hui. Mais je sens quand même que…
En plus, c’est mon troisième. Et elle me dit, non, mais rentrez chez vous. Si c’était pour maintenant ou pour aujourd’hui, vous ne seriez pas comme ça. Tu vois le piège ? Donc si j’exagère, alors j’exagère donc on vient pas me voir parce que j’exagère, j’ai pas si mal que ça. Si j’exprime un petit peu ma douleur mais sans exagérer, et ben c’est pas vrai parce que les gens comme moi exagèrent. Du coup on m’a renvoyé chez moi, je suis revenue 30 minutes après et j’ai accouché sans péridurale.
Clémentine
Un petit aller-retour à la maison qui ne sert à rien.
Racky Ka-Sy
Mais en plus, ils ont un danger. Je veux dire, je rentre chez moi. Mais tu imagines, c’est moi.
Clémentine
Si tu accouches dans le RER, je ne sais pas où, c’est quand même problématique. Ce n’est quand même pas les meilleures conditions.
Racky Ka-Sy
Mais c’est vraiment ça. Ça n’aurait pas été comme ça.
Clémentine
Donc là, c’est ce que tu dis, c’est un personnel soignant sous stress qui doit prendre une décision très vite et qui associe tous les stéréotypes qu’il a engrangés au cours de sa vie et donc qui, au lieu de prendre deux secondes une pause, évaluer l’humain dans son humanité, va juste piocher dans ses stéréotypes sans s’en rendre compte.
Racky Ka-Sy
Oui, absolument. Je pense qu’elle était de bonne foi en me disant non, mais ça va.
Clémentine
Ou peut-être qu’il n’y avait pas assez de place et que ça l’arrangeait. On ne sait jamais aussi.
Racky Ka-Sy
Même pas, même pas. C’était assez calme, même pas. Mais vous ne seriez pas comme ça, sans forcément reprendre des données physiques. Vu mon apparence et vu ce que j’exprime, ça ne colle pas à ce qu’elle connaît des personnes qui me ressemblent. Donc, ce n’est pas encore le cas.
Clémentine
Là, j’ai beaucoup de soignants, soignantes, qui sont mes auditrices et auditeurs. S’ils voulaient faire un premier pas pour se sortir des stéréotypes, des préjugés, qu’est-ce que ça serait la première étape ?
Racky Ka-Sy
En prendre conscience déjà. Enfin déjà ils écoutent le podcast donc c’est bien. C’est vrai. Il y a un petit exercice que j’aime bien donner. La prochaine fois que vous êtes dans les transports en commun, le métro, et que vous regardez les gens, faites attention à vos pensées. Parce que souvent c’est immédiat. Je tiens mon sac, je ne m’assois pas à côté d’un tel, je range mon téléphone parce que je suis à côté d’un tel, Observez-vous la prochaine fois que vous êtes dans les transports en commun, parce que c’est là où on voit le plus de diversité. Ici, après je ne suis pas dans le reste, à Paris, dans le reste de la France ou ailleurs. Peu importe, quand vous êtes dans un lieu avec du public, essayez de vous observer, d’observer vos pensées. Qu’est-ce que vous pensez des gens qui sont autour de vous ? Et là vous allez commencer à prendre conscience de ce dont on parle en fait, tout simplement.
Clémentine
Mais c’est pour ça que d’ailleurs je disais, on est tous racistes. Parce qu’on a tous été conditionnés pour associer des images ou des façons. Tu vois, ce mot racaille, on l’a tellement associé à un type de personne. Même si on n’est pas, si tu me dis racaille, j’ai une image qui vient dans ma tête. Et à moi de faire l’effort de dire non, je ne dois pas l’associer à ça. Et moi, j’ai la sensation de me déconstruire au quotidien. Mais il y a des fois où je me… J’attrape mon cerveau et dis « Mais pourquoi tu penses ça ? Pourquoi est-ce que tu vas sortir d’une chambre avec ton sac alors que si t’étais à l’hôtel, parce que le personnel est racisé ? » De moi-même, je suis obligée de me dire « Non ! » et de revenir en arrière.
Et c’est fou comment la société dans laquelle on vit ne nous aide pas, clairement, mais à quel point on doit lutter contre pour enlever nos propres préjugés.
Racky Ka-Sy
Les préjugés, les stéréotypes sont entretenus par tous les canaux de communication, commençant par les médias, les films, toutes nos lectures, plus toutes les interactions sociales, donc c’est entretenu. Il faut vraiment faire un effort conscient pour lutter contre. Et ça ne se fait pas en un jour, ça se fait pas en une heure, ça se fait tous les jours à partir de maintenant. Faites-le quand vous pouvez. Lisez, renseignez-vous, intéressez-vous au sujet. Puisqu’il ne suffit pas juste de dire bon bah j’utilise pas mes stéréotypes. Mais si, parfois on les utilise et on fait que ça. Mais juste intéressez-vous à l’histoire, à l’histoire de la France, à l’histoire coloniale, à la sociologie, à la psychologie sociale aussi. Intéressez-vous à toutes ces dynamiques pour comprendre finalement. Il ne suffit pas de dire je ne suis pas raciste. Moi je ne dis pas on est tous racistes.
Je ne le dis pas je pense. Franchement je ne pense pas, je pense que beaucoup de gens sont de très bonne volonté. Mais on est tous imprégnés de l’idéologie. On est imprégnés de l’idéologie et c’est difficile de lutter contre parce que tout autour de nous on a plein d’indicateurs qui donnent raison à cette idéologie.
Clémentine
On peut tous avoir des réflexes racistes à un moment, c’est ça que tu as raison.
Racky Ka-Sy
Conscient ou inconscient, souvent très inconscient.
Clémentine
Et donc en santé c’est pareil, d’observer à la limite comment on se comporte avec un ou une patiente racisée et d’avoir la lucidité de se dire j’ai pas agi de la même manière en fait.
Racky Ka-Sy
Est-ce que vous êtes à l’aise ? Est-ce que vous n’êtes pas à l’aise ? Est-ce que vous prenez le temps ?
Des fois c’est vraiment sur des détails. Est-ce que vous proposez à la personne de venir au cours sur l’allaitement la semaine prochaine, qui est optionnelle et que vous ne proposez qu’à certaines personnes ? A qui est-ce que vous l’avez proposé ? Est-ce que vous donnez systématiquement la boîte rose quand vous rencontrez des nouvelles patientes ? Je ne suis pas sûre. Donc c’est sur des gestes comme ça, envers certaines on va être plus humaine, plus accueillant, plus… Ouais, « maternant » j’allais dire, mais… Et envers d’autres c’est… Tu vois, le racisme c’est ça, c’est de la déshumanisation, mais c’est aussi le fait d’écarter. C’est le fait de ne pas voir, c’est le fait de ne pas vouloir voir, donc… Comment est-ce que vous réagissez avec ces personnes-là ?
Clémentine
L’invisibilisation ?
Racky Ka-Sy
Oui, oui.
Clémentine
C’est tout aussi violent ?
Racky Ka-Sy
Oui, mais si ce n’est pire. Si ce n’est pire. Je parlais avec une patiente il y a quelques jours, puisque les personnes qui viennent me voir sont de toutes les origines, partout dans le monde, quasiment tous les fuseaux horaires, et cette personne me parlait justement de l’expérience de racisme qu’elle a vécue dans sa belle-famille. Blanche. Et l’une des expériences, je pense, qui m’a le plus interpellée, c’est cette invisibilisation où certains membres de la famille ne lui ont pas adressé la parole une seule fois pendant tout un week-end. Là, elle adresse quand même la question parce qu’ils en discutent. Mais quand elle amène le sujet, les personnes concernées vont dire non, mais tout va bien.
J’ai rien contre toi, mais ça va jusque-là, c’est-à-dire comment tu réagis face à une personne qui te ressemble pas pendant un dîner, est-ce que tu lui parles pas, tu lui parles de quoi ? Tu lui parles de ses cheveux ou tu lui parles d’autre chose ? Et pendant tout un week-end quoi. C’est hyper violent, alors qu’on est en famille, on est entre amis, donc c’est ça. C’est soit une forme de violence, soit une invisibilisation qui n’existe pas.
Clémentine
Pour terminer, est-ce que tu as la sensation que, on avance ?
Racky Ka-Sy
Dans mon monde, oui. J’ai l’impression que ça avance. Malgré tout, je suis quand même optimiste. Je vois énormément de personnes de bonne volonté, qu’elles soient racisées ou pas, c’est pas la question, puisque ça reste un rapport de pouvoir. Qui va amener le sujet où ? Qui va décider de quoi ? Qui va changer les règles ? Qui va ouvrir l’espace de discussion. J’ai une sage-femme qui est responsable d’une unité en Belgique, et elle a fait ma formation, donc elle est en train de réfléchir à comment amener ces sujets-là dans son service. Qu’est-ce qu’on met en place ? Donc ce sont les personnes qui ont le pouvoir qui peuvent changer les choses. Mais je reste optimiste puisque j’encontre beaucoup de gens qui ont envie de s’informer, qui ont envie de changer un peu leur pratique.
Clémentine
Juste déjà que tu puisses enseigner ce thème.
Racky Ka-Sy
Oui, et puis l’Université de la Sorbonne, qui a eu de très bons retours, on a eu de très bons retours de la part des étudiants, on a eu les félicitations du doyen après notre article du Monde. C’est extrêmement bien, donc j’espère que ce sera pérennisé. C’est dans le temps qu’on verra le changement.
Clémentine
Donc si jamais vous êtes dans des facs ailleurs qu’à Paris, il y a des cours qui existent du coup, on peut te faire venir pour intervenir dans les universités en province. Passer ce savoir aux étudiants, parce qu’on est beaucoup à pas vivre à Paris. On a besoin de médecins formés un peu partout à ce type de problématiques. Merci beaucoup.
Racky Ka-Sy
Merci à toi.